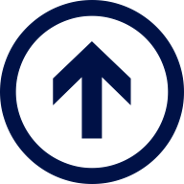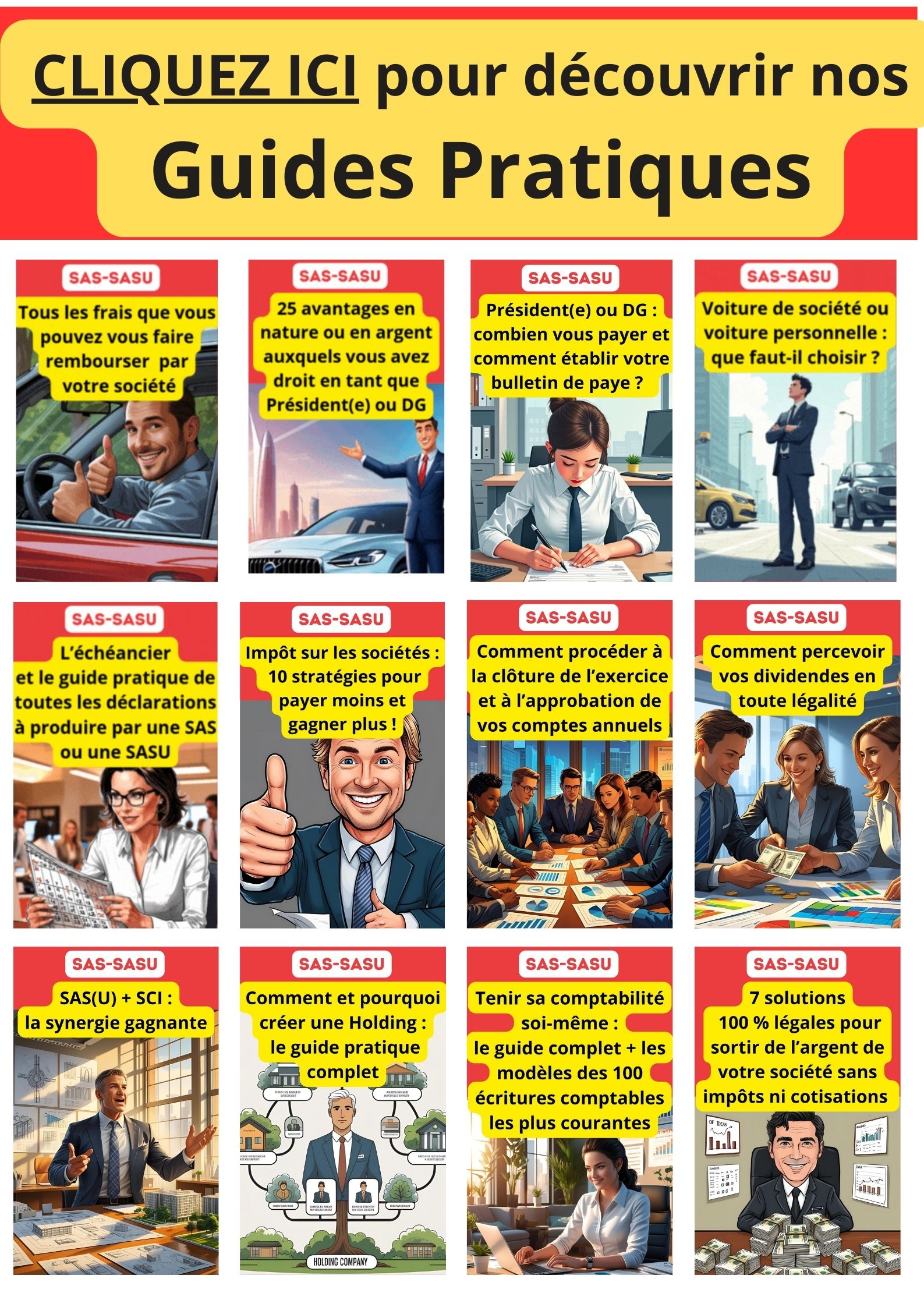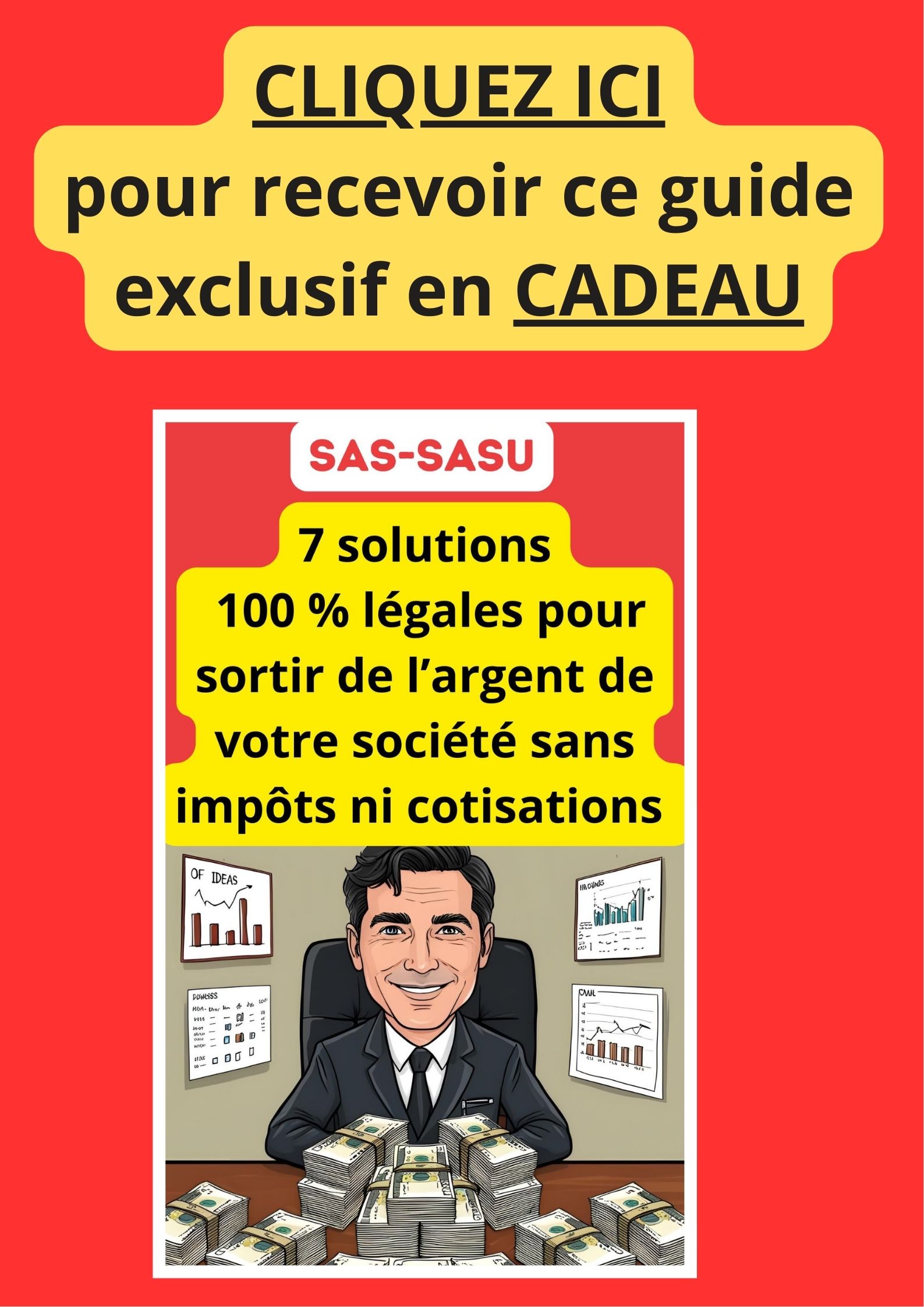Vous avez choisi la SASU pour votre activité, mais vous trouvez que les charges sociales et les impôts pèsent lourdement sur vos revenus ? Le statut de micro-entrepreneur serait-il plus intéressant pour vous ?
Dans cet article, nous allons comparer les deux statuts pour que vous puissiez faire un choix éclairé, et déterminer s’il est réellement plus intéressant de changer de régime juridique.
Qu’est-ce que le régime micro-entrepreneur ?
Autrefois appelé auto-entrepreneur, le régime du micro-entrepreneur a l’avantage d’être très simplifié au niveau de la comptabilité puisque seul un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail des recettes, appuyées de factures, doit être tenu. Toutefois, un journal des achats de marchandises doit également être tenu pour les activités de négoce.
Sur le plan fiscal en outre, il n’y a pas de déclaration annuelle de résultat à produire, le micro-entrepreneur devant simplement déclarer son chiffre d’affaires sur sa déclaration personnelle de revenus.
Enfin, ce régime peut également s’avérer intéressant au niveau du montant et du mode de calcul des charges sociales et des impôts.
SASU ou micro-entrepreneur : qui gagne le plus à chiffre d’affaires identique ?
Comparer le revenu net de l’associé unique d’une SASU avec celui d’un micro-entrepreneur n’est pas évident au premier abord puisque, alors que les charges sociales et l’impôt sur le revenu du premier sont calculés sur sa rémunération, ceux du micro-entrepreneur sont déterminés, non pas à partir de ce qu’il gagne réellement, mais à partir de son chiffre d’affaires HT. Et comme chacun sait, il ne faut pas confondre chiffre d’affaires et bénéfice.
C’est la raison pour laquelle, pour notre simulation, nous partons du chiffre d’affaires dans tous les cas, tout en en déduisant un certain montant de frais généraux, identique pour tous, afin d’obtenir le bénéfice distribuable.
Autre problème, le taux des charges sociales des micro-entrepreneurs est différent selon l’activité qu’ils exercent. Il s’élève à :
- 12,3 % du chiffre d’affaires pour les ventes de marchandises ;
- 6 % pour les locations meublées de tourisme ;
- 21,2 % pour les prestations de services (BIC) et les locations meublées autres que de tourisme ;
- 24,6 % pour les professions libérales non réglementées (BNC).
Ce sont ces deux derniers taux, à savoir 24,6 % pour un BNC, et 21,2 % pour un BIC, que nous retenons pour notre première simulation. Notre entrepreneur « cobaye » exerce donc :
- soit une profession libérale non réglementée (Consultant, conseil, développeur, formateur, rédacteur, coach, sophrologue, naturopathe, expert foncier, etc.) auquel cas il relève des BNC ;
- soit une activité de prestation de service, auquel cas il relève des BIC.
Attention : il convient de bien déterminer la nature de l’activité exercée, entre BNC ou BIC, car l’abattement dont bénéficie le micro-entrepreneur sur son revenu imposable est nettement différent : pour un BNC, cet abattement est de 34 %, tandis que pour un BIC, il est de 50 % (contre 10 % pour l’associé unique d’une SASU qui perçoit une rémunération).
Par contre, que l’on réalise des BNC ou des BIC, le chiffre d’affaires maximum qui permet de bénéficier du statut de micro-entrepreneur est identique dans les deux cas, à savoir 77.700 € HT pour un an. C’est donc ce montant que nous retenons pour notre simulation. Notons qu’il s’agit du chiffre d’affaires réellement encaissé. Les factures clients non payées à la fin de l’année ne doivent pas être prises en compte.
Pour ce qui concerne les frais d’exploitation, nous retenons pour ce premier exemple, un montant égal à 5 % du chiffre d’affaires. Nous verrons ensuite ce qu’il en est avec des taux de 10 ou de 15 %.
Enfin, pour ce qui concerne la SASU, nous considérons que l’associé unique se verse la totalité de son bénéfice net après déduction des frais généraux et de ses charges sociales, soit sous la forme d’une rémunération, auquel cas il ne paye pas d’IS, soit sous la forme de dividendes. C’est donc soit 100 % rémunération, soit 100 % dividendes.
Les données du problème étant posées, voici la solution :
Tableau comparatif du gain net obtenu avec un chiffre d’affaires de 77.700 € et 5 % de frais, selon que l’on exerce en SASU à l’IS ou sous le statut de micro-entrepreneur
| SASU IS | Micro-entrepreneur | |||
|---|---|---|---|---|
| 100 % Rém | 100 % Rém. | BNC | BIC | |
| Chiffre d’affaires HT | 77.700 | 77.700 | 77.700 | 77.700 |
| Frais (5 %) | 3.885 | 3.885 | 3.885 | 3.885 |
| Bénéfice brut | 73.815 | 73.815 | 73.815 | 73.815 |
| Impôt sur les sociétés | 14.204 | |||
| Charges sociales | 32.626 | 10.253 | 19.114 | 16.472 |
| Rému ou dividendes | 41.189 | 49.358 | 54.701 | 57.343 |
| CSG non déductible | 2.469 | 0 | 0 | 0 |
| Abattement fiscal | 10 % | 40 % | 34 % | 50 % |
| Revenu imposable | 39.442 | 35.767 | 51.282 | 38.850 |
| IR (pour 1 part) | 4.953 | 3.896 | 8.550 | 4.820 |
| Gain net | 36.236 | 45.462 | 46.151 | 52.523 |
Conclusion
Comme on peut le voir, dès lors que l’activité exercée consiste à proposer des prestations de services, le statut de micro-entrepreneur est nettement plus favorable que celui d’associé unique de SASU. A chiffre d’affaires et frais identiques, le micro-entrepreneur peut gagner jusqu’à 10.000 € de plus par an qu’en SASU.
Mais peut-être trouvez-vous que 5 % de frais seulement, c’est trop peu ? Dans ce cas, voici les résultats avec 10 % ou 15 % de frais :
Exemples : même simulation que ci-dessus, avec un chiffre d’affaires de 77.700 €, mais avec un pourcentage de frais égal à 10 % ou à 15 %
| SASU IS | Micro-entrepreneur | |||
|---|---|---|---|---|
| C.A. HT = 77.700 € | 100 % Rém. | 100 % Div. | BNC | BIC |
| Gain net avec Frais = 10 % | 34.619 | 43.575 | 42.266 | 48.638 |
| Gain net avec Frais = 15 % | 33.094 | 41.687 | 42.266 | 48.638 |
Comme on peut le voir, le micro-entrepreneur reste gagnant dans pratiquement tous les cas.
Activité de vente de marchandises
Pour un micro-entrepreneur qui exerce une activité de vente de marchandises, le chiffre d’affaires maximal à ne pas franchir est fixé à 188.700 € HT, le taux des charges à 12,3 %, et l’abattement sur le revenu imposable à 71 %.
Compte tenu de ces particularités et en faisant la même simulation que ci-dessus, il apparaît là encore que, jusqu’à 40 % de marge (prix d’achat des marchandises + frais généraux = 60 % du chiffre d’affaires), c’est encore le micro-entrepreneur qui monte sur la première marche du podium.
Exemple pour une activité de vente de marchandises avec un chiffre d’affaires de 188.700 € HT et 50 % de marge nette
| SASU | Micro-entrepreneur | |||
|---|---|---|---|---|
| C.A. HT = 188.700 € | 100 % Rém. | 100 % Div. | ||
| Gain net avec Frais = 50 % | 44.794 | 52.116 | 61.358 | |
Comment passer sous le régime du micro-entrepreneur ?
Si vous êtes en SASU (à l’IS ou à l’IR), il n’est pas possible de passer directement sous le régime du micro-entrepreneur (alors qu’en EURL c’est possible). Vous devez d’abord fermer votre société puis vous inscrire en tant qu’entrepreneur individuel.
Cependant, attention, s’il peut s’avérer intéressant financièrement, comme on vient de le voir, et aussi grâce à sa gestion très simplifiée, le statut de micro-entrepreneur peut aussi comporter des inconvénients.
Inconvénients du statut de micro-entrepreneur
En premier lieu, l’adoption du statut de micro-entrepreneur est déconseillée si l’activité nécessite de réaliser des investissements importants (matériel informatique coûteux, véhicule, matériel de BTP, etc.), car dans ce cas, les amortissements n’étant pas déductibles sous ce statut, le dirigeant risque d’être perdant au niveau des impôts et des cotisations (sans parler de la non récupération de la TVA).
De même, ce statut est forcément déconseillé si on sait par avance que l’activité va générer un déficit la ou les premières années. Car dans ce cas en effet, le micro-entrepreneur devrait payer des cotisations sociales et des impôts sur le chiffre d’affaires réalisé, alors même qu’il ne gagne rien.
Par ailleurs, contrairement à l’associé unique d’une SASU, dont la responsabilité est limitée à ses apports (sauf en cas de faute de gestion ou s’il s’est porté caution pour sa société), la responsabilité du micro-entrepreneur est… illimitée. En cas de dettes donc, ses créanciers peuvent demander la saisie de ses biens personnels (sauf de sa résidence principale mais à condition qu’il ait effectué une déclaration d’insaisissabilité chez un notaire).
Enfin la limite de chiffre d’affaires est également un handicap pour les entreprises qui sont appelées à se développer. En cas de franchissement pendant deux années consécutives, le micro-entrepreneur redevient un entrepreneur individuel « classique » à partir du 1er janvier de l’année suivante. Il est donc soumis au régime réel d’imposition, ce qui l’oblige à tenir une comptabilité et à établir une déclaration annuelle de résultat. Enfin, il est assujetti aux charges des TNS et à l’impôt sur le revenu sur la totalité du bénéfice de son entreprise (y compris lorsqu’il le réinvestit en partie et qu’il ne le perçoit donc pas en totalité).
NB : dans le cas où, après ce dépassement, le chiffre d’affaires redevient inférieur ou égal au seuil admis, le régime réel reste applicable au titre de l’année au cours de laquelle il passe en deçà du seuil, mais le régime micro s’applique à nouveau de plein droit au titre de l’année suivante (sauf option délibérée pour le régime réel d’imposition).
En résumé donc, le statut de micro-entrepreneur ne peut convenir qu’à une activité :
- ne demandant pas beaucoup d’investissements ni de stocks ;
- ne nécessitant pas d’emprunt ;
- ne générant pas de dettes, ni de déficit ;
- et n’étant pas appelée à se développer trop rapidement.